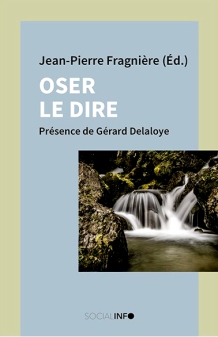Le 5 décembre 2016 Gérard Delaloye, auteur de ce blog, est decedé à Sibiu.
Par la volonté de son épouse Adriana et le désir de ses amis,
on a décidé de garder en ligne le blog, témoin, à coté des livres qu’il a écrit,
des interêts et des passions intellectuelles de Gérard.
Le blog reste ouvert à tous ceux qui désirent envoyer un texte personnel
lié à la mémoire de Gérard, en n’importe quelle langue.
Envoyer à gerardsibiel@gmail.com
DOVE FINISCE LA FRONTIERA
di Giovanni Ruggeri
Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 2016, si è spento a Sibiu (Romania) Gérard Delaloye, raffinato intellettuale svizzero stabilitosi da molti anni nel sud della Transilvania, a Sibiel, insieme alla sua sposa Adriana, romena. Assiduo lettore della nostra rivista Orizzonti Culturali Italo-Romeni (solo una banale mancanza di coincidenze ha impedito che ne fosse anche collaboratore), Gérard Delaloye è stato uno storico e un giornalista di prim’ordine, che alla Romania ha dedicato diverse pubblicazioni, nelle quali la profondità e il rigore dello storico di lungo corso si sono espresse con la prosa brillante e avvincente del giornalista di profilo.
Nato nel 1941 a Lourtier, nel Canton Vallese, dopo gli studi liceali presso il collegio Saint-Maurice gestito da religiosi (eredità questa che rimarrà per sempre nella sua vita come una sorta di polo dialettico, tra polemica verso un mondo clericale sclerotizzato e rispetto verso la dimensione religiosa in quanto tale), Gérard Delaloye si laurea in Lettere a Losanna, per poi insegnare storia a Ginevra. Negli anni Settanta, un’antica inclinazione verso il giornalismo lo porta a collaborare a diverse pubblicazioni, con un rapporto via via più consistente e regolare (nel 1978 al Journal du Valais, nel 1980 a L’Hebdo), finché nel 1991 lascia l’insegnamento per partecipare alla fondazione del Nouveau Quotidien, dove si occupa di politica estera, storia e letteratura. Spirito libero e aperto, nel 1998 prende parte al lancio del quotidiano Le Temps, con il quale continua a collaborare fino agli ultimi anni, tenendo al contempo alcune rubriche su siti di informazione svizzera come dimanche.ch, Largeur.com e Matin Dimanche.
«Uomo di cultura eccezionale, aperta a diversi orizzonti, la Francia, la Germania, l’Italia e, in questi ultimi anni, la Romania e l’Europa dell’Est. Un grande europeo». Le parole dell’amico Jacques Pilet sintetizzano al meglio un tratto essenziale della personalità umana e del profilo intellettuale di Gérard Delaloye che, mai dimentico delle sue origini svizzere, cui ha dedicato diversi libri (tra questi, La Suisse à contre-poil, nel 2006, e L’évêque, la Réforme et les Valaisans nel 2009), investe gli ultimi dieci anni della sua vita nello studio sistematico della storia della Romania, in particolare della Transilvania. Trasferitosi definitivamente, nel 2007, da Losanna al villaggio di Sibiel, vicino a Sibiu, assecondando un desiderio maturato con la moglie Adriana – anche sulla scia della testimonianza di un altro grande “straniero naturalizzatosi romeno”, il compianto professore belga Eugène van Itterbeeck, studioso dell’opera di Cioran e iniziatore a Sibiu dei seminari internazionali annuali su Emil Cioran – Gérard Delaloye matura una conoscenza accurata di aspetti essenziali del passato e del presente della Romania, che gli consente di evidenziare parallelismi, o quanto meno analogie, con alcune dinamiche della storia elvetica, come nel caso della composizione multietnica della Transilvania (di grande interesse questo saggio pubblicato in romeno sulla celebre Revista 22 di Bucarest).
Nascono da questo lavoro di ricerca, ma anche dal piacere della discussione e della divulgazione, le sue due opere più recenti: il blog personale Carrefour est-ouest che ha tenuto con regolare costanza negli ultimi anni, commentando fatti del presente e del passato della Romania, e l’ultimo suo recente libro (in francese), il cui titolo pare oggi un presagio del suo “passaggio”: Les Douanes de l’âme (Ed. L’Aire, Vevey 2016). Figlio di un doganiere del Vallese, Gérard Delaloye riconduce le pluriennali incursioni nello spazio socioculturale romeno alla dimensione metaforica della frontiera, scegliendo per questo suo libro un titolo ispirato a un rito e credenza da lui scoperti in Romania, in occasione delle esequie di suo suocero: «Quando il prete finì di incensare le offerte, noi ci avvicinammo per reggere il vaso con la colivă [un dolce tipico utilizzato nella liturgia funebre presso gli ortodossi romeni, ndr] e con il vino e sollevarlo ritmicamente verso il cielo, per accompagnare simbolicamente l’anima, lavarla dai suoi peccati, sostenerla nel suo passaggio delle dogane dell’anima».
E proprio Les douanes de l’âme ci appare oggi come una sorta di testamento culturale, non privo di risonanze affettive. Nei dodici testi in gran parte inediti, sfilano alcuni dei nomi e temi più significativi del paesaggio romeno, accostati con personale originalità. Accade così, ad esempio, con il saggio sulle origini byroniane del Dracula di Bram Syoker, o con quello dedicato all’ispiratore transilvano di Hergé e del suo viaggio sulla luna, mentre una posizione centrale è riservata alla migrazione dei Sassoni di Transilvania, letta in paralleo con quella dei Walser nel Vallese. L’accostamento Transilvania-Svizzera emerge con decisione anche quando vengono affrontate le analogie multietniche della Svizzera e dei Sieben Bürgen, dei luterani in Transilvania e dei seguaci di Michel Servet, e sempre di multiculturalità si tratta nel caso ad esempio della Transilvania un tempo ungherese o della Bucovina in alcune zone – come a Cernăuţi/Černivci – fino al 1918 a maggioranza ebraica. Personalità di prima grandezza sfilano nel viaggio de Les douanes de l’âme, dove la multiculturalità è cifra costante: è il caso del ritratto dedicato a Miklós Bánffy, l’aristocratico ungherese di Cluj, del breve saggio su Paul Celan, il poeta ebreo di Cernăuţi/Černivci, e delle pagine su Herta Müller, Nobel della letteratura 2009, originaria del Banato.
La metafora del viaggio, nel caso di Gérard Delaloye, è costitutiva, e non solo perché già nel 2009 egli aveva pubblicato uno splendido diario culturale intitolato proprio Le voyageur (presque) immobile (Ed. de L’Aire, Vevey), testimonianza suggestiva del suo spessore culturale, ma anche perché il movimento agile della curiosità intellettuale e della fisica disponibilità a dislocarsi su orizzonti diversi ne hanno caratterizzato la vicenda umana e culturale. Mi permetto di aggiungere che ho avuto la fortuna e il dono di avere Gérard come amico, un amico sincero, un vero signore, un uomo che sotto una riservatezza tutta “svizzera” custodiva un animo buono e autentico. La scomparsa di persone come lui è una grave perdita non solo per coloro che lo hanno amato – alla sua sposa Adriana vanno le nostre condoglianze – ma anche, e per certi versi anzitutto, per il Paese che egli ha amato, la Romania, oggi più che mai bisognosa, in un contesto globalizzato, di non perdere contatto e consapevolezza delle sue radici culturali e antropologiche. Queste, con passione e intelligenza, Gérard Delaloye non ha mai cessato di indagare e porre in valore.
Qui l’audio con l’ultima intervista a Gérard Delaloye in occasione della pubblicazione del suo libro, trasmessa dalla radio svizzera RTS.
(articolo pubblicato in
Orizzonti Culturali Italo-Romeni, gennaio 2017)
NOS IMPATIENCES COMMUNES, MAIS PLEINES D’ESPOIR
de Daniel de Roulet
Le 11 octobre 2016, Gérard Delaloye a rédigé sa dernière contribution au blog Carrefour est-ouest qu’il alimentait régulièrement. En général, il nous écrivait depuis la Roumanie où il avait élu domicile aux côtés de sa compagne, Adriana. Mais ce jour-là il était à Lausanne.
Le lendemain matin, Gérard m’a téléphoné pour qu’on prenne rendez-vous. Comme à chaque fois qu’il passait en Suisse, il faisait la tournée de ses nombreux amis. Depuis longtemps j’avais pris l’habitude de me disputer avec lui sur toutes sortes de sujets politiques d’abord, littéraires plus tard. À la fin des années 60, notre première rencontre avait eu lieu dans la belle maison où il vivait à Carona au Tessin. Gérard avait badigeonné de grandes lettres qui remplissaient toute la paroi d’une grande cuisine au plafond vouté : « Padroni, borghesi, ancora pochi mesi ». Il n’était alors pas seul à penser que le système capitaliste allait s’effondrer dans peu de mois. Plus réaliste, je lui avais proposé d’adoucir la formule en : « Padroni, broghesi, ancora pochi anni ». Il m’avait traité de réformiste petit-bourgeois, injure suprême de l’époque.
Un demi-siècle plus tard, le 12 octobre 2016, Gérard au téléphone pour un rendez-vous. On se rencontrait en général dans un bistrot pour manger, boire un verre. On faisait le tour de la situation mondiale, oui rien que ça : une élection par ci, des barricades par là et, seulement ensuite, on parlait de la Suisse dont il connaissait mieux que moi personnel politique et institutions.
Il était historien, il avait été journaliste. À chacune de nos rencontres, on ajoutait quelque nouvel argument à nos points de vue. On finissait souvent par évoquer les gens que nous avions connus, ceux dont la santé déclinait, celui-là avec sa nouvelle femme, celle-là avec l’article qu’elle avait publié, un autre encore passé du côté des renégats. Lui-même, au fil des ans, critiquait mon manque de réalisme et moi son pessimisme. On n’avait pas de contentieux, de ces non-dits, de ces tricheries qui minent les rapports. On était loin de s’entendre sur tout et notamment sur notre degré de dissidence, on se le disait, c’est ça l’amitié.
Ce matin-là on comparait donc nos agendas pour un rendez-vous quand il m’a dit que le soir même il irait voir l’Orfeo de Monteverdi à l’opéra de Lausanne avec Adriana. Comme par hasard, j’y allais moi aussi, accompagné. On a décidé de se retrouver tous les quatre à l’entrée de la salle. Ç’aurait été une première, nous quatre à l’opéra. Ce n’était pas vraiment son genre ni le mien de fréquenter le public qu’on rencontre en ces lieux : notables, bourgeois sur leur trente et un, champagne à l’entracte. Ç’aurait peut-être été le signe qu’on s’embourgeoisait. Je me réjouissais de le lui reprocher.
Le soir, à sept heures moins le quart, Adriana était seule sur le trottoir devant la salle. Elle n’avait pas bonne mine, nous a dit : « Gérard est à l’hôpital, un malaise, on ne sait pas quoi. » Elle nous a quittés, nous avons pris nos places. J’ai suivi l’Orfeo d’une oreille et d’un œil distraits. On connaît le sujet. Orphée descend aux enfers pour arracher sa bien-aimée aux griffes de la mort. Je me souviens que pendant tout le spectacle je me suis demandé ce que pouvait bien faire Gérard à l’hôpital. Si c’était le début de la fin pour lui, un sérieux avertissement ou juste une mauvaise passe comme en ont ces faux vieillards qui ressortent des soins intensifs tout requinqués quarante-huit heures plus tard. Et qu’est-ce qu’un Orphée d’aujourd’hui pourrait bien faire pour arracher son ami aux griffes des maîtres de l’enfer ? Contrairement à la mythologie, dans l’Orfeo de Monteverdi, la fin est heureuse. Eurydice meurt par la faute d’Orphée qui avait promis de ne pas se retourner tant qu’ils ne seraient pas tous deux revenus sur Terre. Mais, grâce à un deus ex machina, Apollon se présente au bon moment pour emmener Orphée au ciel parmi les dieux.
En sortant de l’opéra dans la nuit lausannoise, j’ai pensé, un peu superstitieux : pour Gérard, c’est bon signe. Hélas, Monteverdi avait tort. Aucun Orphée triomphant n’a pu sauver Gérard.
Quand je pense à lui, je ne peux m’empêcher de sourire de nos impatiences communes, mais pleines d’espoir… Alors, Gérard, encore quelques mois ou quelques années ? Ici se termine ton blog. Mais il reste ouvert, accessible à tous ceux pour qui ta prose lucide a beaucoup compté. Merci.
HOMMAGE À MON AMI GÉRARD DELALOYE
de Raymond Ganguin
Je voudrais par la présente, rendre hommage à Gérard,
Malheureusement, merveilleuse personne connue sur le tard
A mon arrivée dans notre chambre d’hôpital,
Il m’a dit : Moi c’est Gérard, nous sommes sur le même bateau
Alors on peut se tutoyer, cela sera plus facile.
Ce fut le départ de quinze jours d’une formidable complicité.
Pris malgré nous dans cette croisière hospitalière
Pour nous, le paquebot CHUV nous donnait l’impression,
De traverser quelques fois des tempêtes, qui nous faisaient tanguer
De pertes d’équilibre ou de repaires nous essayons de le prendre avec sourire.
Nous nous encouragions à bien rester à flots, malgré les remous intérieurs,
Et nous nous rendions mutuellement de petits services.
J’ai gardé souvenir qu’un soir, à la visite et l’étonnement de l’infirmière,
Elle nous a trouvé, assis côte à côte sur mon lit, a regarder sur l’ordinateur,
L’émission « C’était mieux avant » sur la télévision suisse.
Puis, grâce à l’internet, retrouver sa maison en Roumanie.
Que des discussions également, venant d’un homme d’une rare distinction,
Me parlant de son enfance, avec son père douanier, ses études,
Son statut d’instituteur, puis de journaliste, et enfin d’écrivain.
Ce fût un bref moment de mon existence, et son départ m’attriste infiniment,
Mais je tiens à le remercier pour les moments d’exceptions que nous avons vécu
Et avoir pu fairela connaissance d’un grand Monsieur
Qui gardera une très grande place dans mon cœur.
Alors qu’une page du grand livre de la vie se tourne, il voulait avant de partir
Retrouver sa patrie d’adoption et de là, entamer son dernier voyage.
Alors à sa femme Adriana et sa famille, remercions Gérard d’avoir été parmi nous
Et lui souhaitons un grand et beau voyage dans les étoiles.
POUR SALUER LE VOYAGEUR PRESQUE IMMOBILE
de Catherine Lovey
Quelques mois après avoir accompagné la sortie de son dernier livre, Les douanes de l’âme Gérard Delaloye est mort, le 5 décembre 2016, à l’âge de septante-cinq ans. Il avait été prof, puis historien, journaliste, auteur, lecteur, observateur, analyseur, fouilleur, arpenteur et coupeur de cheveux en quatre. Il lui faudra encore sept années, si l’on en croit un ancien rite orthodoxe, pour parvenir à franchir ces douanes qui marquent la séparation entre l’ici-bas et l’au-delà.
Plutôt que de jeter quelques piécettes, comme on le fait parfois encore en Roumanie au passage d’un cercueil, ou de mettre sur sa tombe, à la mode de chez nous, fleurs et bougies ou, pourquoi pas, des répliques en papier de billets de banque, de smartphones et d’ordinateurs, ainsi que le pratique désormais la Chine consumériste, afin que le défunt ne manque d’aucun de ces biens devenus si indispensables à la vie sur terre qu’ils ne peuvent qu’être présumés utiles dans la mort, j’aimerais déposer quelques mots en son nom, qui sont ceux de la gratitude.
Depuis quelques années, ma bibliothèque accueille un certain nombre de livres qui m’ont été donnés par Gérard Delaloye, à l’époque où il était en train de vider son appartement lausannois pour s’établir définitivement en Roumanie. Le jour où je m’étais rendue dans cet appartement, c’était la première fois que je le rencontrais. Jusque-là, nous avions seulement eu l’occasion de correspondre un peu, à l’occasion de la sortie de Un roman russe et drôle en 2010. Mais cela avait suffi pour que Gérard en déduise que j’étais le genre d’oiseau susceptible de le débarrasser d’ouvrages devenus extrêmement peu cotés sur le marché : bolchévisme et soviétisme à la sauce quasi-encyclopédique, textes historico-politiques en veux-tu en voilà, dissidence en bonne et due forme, procès de Moscou et, bien entendu, du Lénine, du Boukovsky, du Soljenitsyne, du Zinoviev, du Sakharov, du Wat etc., sans oublier du bon gros communisme, certes soluble dans l’alcool mais surtout dans le temps qui passe. Bref, tout un univers de pensées, si proches encore, et qui avaient pourtant l’air presque empaillées.
PARLER CHIFFON
C’est ainsi que je m’étais retrouvée face à une bibliothèque dans laquelle j’avais pu puiser tout mon saoul. Gérard avait bien entendu fait le ménage et pensait l’avoir bien fait. Or, j’ai perçu tout de suite une assez grande communauté des âmes. La communauté de ceux qui ne sauraient voir partir des livres sans ressentir, au-delà du soulagement, un assez vif pincement au niveau des entrailles. Non pas que ces ouvrages aient la moindre importance désormais. En revanche, l’individu qui avait autrefois acheté ce livre, l’avait lu, puis avait pris la peine de lui faire une place dans sa bibliothèque, eh bien ce jeune-vieux bougre continue à en avoir, lui, de l’importance !
Comment oublier le lecteur que nous avons été ? Celui qui, à vingt ans, s’était demandé si, là-bas, ils n’avaient pas par hasard trouvé un système moins injuste où l’homme pouvait vivre mieux. Puis celui qui a commencé à avoir des doutes. Les a cultivés. A cherché. Systématiquement. Inlassablement. Celui qui a lu à la folie, relu, creusé et découvert de nouveaux horizons, de nouvelles questions. C’est fou ce qu’un tel lecteur peut demeurer vivant à l’intérieur de nous ! Il faudrait plutôt écrire de tels lecteurs, tant ils sont nombreux. Chaque livre conservé au fil des ans témoigne, bien au-delà de son strict contenu, de ce que nous fûmes, de ce qui nous a animé, de nos enthousiasmes et errements, des odeurs et couleurs qui nous environnaient et, immanquablement, de ceux que nous aimions et qui nous aimaient. Si bien que lorsqu’il faut faire le tri dans sa bibliothèque, c’est d’abord à des chapitres de soi-même qu’on ne cesse de devoir dire adieu.
Pour des gens qui vivent en grande partie par et pour les livres, rien n’est plus fascinant que de faire connaissance autour d’une bibliothèque. C’est un peu comme parler chiffon, mais dans le détail, sans s’épargner la poussière ni le récit des petites misères.
Dans mon souvenir, nous n’avions, ce jour-là, pas échangé un seul mot à propos du Valais, dont nous sommes pourtant tous deux originaires. Tel n’était pas notre point de rencontre, bien que Gérard n’ait jamais quitté ce canton des yeux, et encore moins de la plume, y compris après avoir cessé d’être le directeur du Musée cantonal d’Histoire militaire de St- Maurice. J’en ignore d’ailleurs tout, je veux dire de ce musée et de ce poste, si ce n’est que je trouve amusant qu’on ait laissé pareil esprit s’asseoir dans de ce genre de fauteuil…
Le fait est que les livres qui encombraient encore la bibliothèque à libérer regardaient presque tous vers l’Est. Et voilà que, sans nous connaître, c’était aussi dans cette direction qu’incurablement, mais pas exclusivement, nous avions tendance à regarder. Pas seulement la politique, pas seulement le sinistre envers de l’utopie, mais les us et coutumes quotidiens, les langues, les traditions culinaires, musicales, les manières d’appréhender le temps et la mort. Sans compter que Gérard allait s’y installer pour de bon, dans la Roumanie de son épouse Adriana. Tous deux avaient choisi une région de forêts vallonnées, qui promettait d’être aussi vivable qu’un morceau encore vert de l’Helvétie, tout en offrant la proximité de Sibiu, une belle ville de culture qui devrait faire oublier la distance avec Bucarest.
UN VOYAGE ROUMAIN
Un peu plus tard, après un hiver transylvain qui avait été aussi rude que ceux du Valais d’autrefois, Gérard avait écrit à un certain nombre de ses connaissances et amis pour proposer à qui le voudrait bien de faire un voyage estival en Roumanie, histoire d’en avoir le cœur net. Du tourisme certes, mais culturel avant tout. En petit groupe. Accompagné d’une jeune guide, Ioana Pau, originaire de Sibiel, le village où ils vivaient désormais. Et épaulé, bien entendu, par un Gérard pas mécontent de partager quelques-unes de ses nouvelles passions, parmi lesquelles l’histoire des Saxons de Transylvanie. Inutile de dire que j’ignorais tout – et sans doute n’étais-je pas la seule – de cette importante population d’origine allemande, dont la trajectoire roumaine ne s’est pas révélée tranquille, ni même reluisante, en particulier pendant et après la deuxième guerre mondiale.
Ainsi fut donc fait, sur des routes dont nous découvrîmes aussitôt le côté cahotant, ce qui nous obligea à multiplier les kilomètres annoncés par un facteur de temps bien plus élevé que celui qui a cours plus à l’ouest de l’Europe… Un voyage fort intéressant, que je vais m’abstenir de raconter ici dans le détail, si ce n’est pour dire qu’il nous permit d’abord de faire connaissance entre nous, compagnons de route improvisés, et de comprendre que nos horizons étaient aussi divers que compatibles. L’itinéraire choisi contribua à nous donner une meilleure idée de la grande diversité géographique et culturelle de ce pays, qui n’est pas constitué que de monastères et d’églises épatants, bien que tous valent le détour. Chaque voyageur en aura gardé ses propres souvenirs exclusifs. Les miens sont surtout liés à la découverte de chemins de campagne et de doux vergers dans les environs de Sibiel. À l’impression toute soviétique que m’avait faite la ville de Bacau. Et à ce petit cortège funéraire que nous avions croisé je ne sais plus où, ce qui nous avait valu, sans politesse supplémentaire, d’être invités par la famille du défunt à la collation funéraire en plein air. Celle-ci s’était tenue à côté du cimetière, à même le coffre ouvert d’une ou deux voitures qui avaient transporté ce que de discrètes femmes, qui nous entouraient en foulards et robes noires, avaient sans doute passé beaucoup de temps à préparer. J’en garde une couronne de pain tressée qui nous avait été offerte, et qui s’est très bien conservée, enveloppée dans une page du Jurnalul National, datée du mercredi 11 juillet 2012.
Quant aux discussions, elles sautèrent du coq à l’âne durant ce voyage, non sans détours du côté de l’histoire roumaine, si méconnue, mouvante, et tellement pleine de minorités qu’on a vite fait de déclarer forfait. Je me rappelle aussi que, presque fatalement, certaines conversations avec Gérard nous avaient conduits encore un peu plus à l’Est, du côté de l’Ukraine. Tous deux lecteurs passionnés de Vassili Grossman, il avait été question, à un moment donné, de retrouver le nom de la ville d’origine de l’écrivain, celle où sa mère avait été assassinée, en même temps que 35’000 autres juifs. Eh bien ce nom, nous avions fini par lui mettre la main dessus, en plein soleil et sans recourir au moindre écran connecté, et c’est Berditchev !
FÉROCE APPÉTIT
Delaloye est un homme des livres, c’est en tout cas ainsi que je l’ai – un peu – connu, et c’est ce qu’il me laisse. Pas seulement les livres qui sont désormais dans ma bibliothèque, mais surtout ceux qu’il m’a encouragée à lire, souvent sans même le savoir, que ce soit à travers les articles auxquels nous pouvons toujours accéder sur son blog Carrefour est-ouest et surtout par l’entremise de son Journal, magnifiquement intitulé Le Voyageur (presque) immobile paru aux éditions de L’Aire en 2009.
Le seul reproche que je puisse adresser à ce Voyageur pas si immobile, c’est de ne pas être assez épais. Sans doute l’indice d’un homme occupé à fouetter trop de chats à la fois. Pour le reste, j’en recommande vivement la lecture, voire la relecture, car rien ne nous incite mieux à nous plonger, à notre tour, dans l’œuvre de ceux que Gérard désigne comme étant des « écrivains du moi », et chez lesquels il a entrepris des incursions aussi personnelles qu’enthousiastes.
Comment ne pas foncer acheter ou emprunter Mes Soldats de papier de Victor Klemperer, après avoir lu ce que ce texte a provoqué chez celui qui s’y est plongé, s’en est retrouvé captif durant six ou sept semaines, et a pris la peine de nous le faire savoir ? Car ce qui nous entraîne, c’est bien sûr aussi le côté subjectif de Delaloye en tant que lecteur averti, qui sait partager, livrer ses impressions, faire ses petites observations et comparaisons, penser à voix haute, dire quand ça l’ennuie, quand il n’est pas d’accord, et dire aussi quand il est complètement chamboulé. Bref, le lecteur capable de transmettre. Voici ce qu’il écrit notamment, le 12 octobre 2000, à propos du Journal de ce Klemperer, qui a tenu d’une manière magistrale la chronique quotidienne du nazisme en train de s’emparer de tout un peuple : « J’en ai lu début septembre deux ou trois cents pages pour en faire une brève recension dans l’hebdomadaire dimanche.ch. Je pensais m’en tenir là. Erreur ! Je n’ai plus décroché et, après lecture des 1500 pages qui suivent, je suis encore complètement sonné. Dès ma journée de travail terminée, je n’avais qu’une hâte, me replonger dans les vicissitudes de la quotidienneté de cet homme dont le mode de vie, le caractère, les ambitions n’avaient à priori rien pour me plaire. ».
Et que dire du journal de Christa Wolf Un jour dans l’année.1960-2000 sur lequel je n’ai pas tardé à me précipiter, moi aussi, après avoir découvert ce qu’en avait pensé Gérard qui n’avait rien lu non plus de cette écrivain est-allemande jusqu’en 2006. « Il m’arrive rarement d’acheter le livre d’un auteur inconnu en ne me fiant qu’à la quatrième page de couverture. Ces quelques lignes m’ont pourtant séduit : « En 1935, Maxime Gorki avait invité les écrivains du monde à raconter une journée de leur vie, la même date pour tous, le 27 septembre. L’idée avait été reprise en 1960, et une nouvelle génération s’était alors essayée à l’exercice. À cette date, Christa Wolf eut envie de relever le défi, elle tint donc la chronique de cette journée du 27 septembre 1960, puis, prise par le jeu, s’astreignit à cette discipline jusqu’à aujourd’hui, soit pendant plus de quarante ans. »
Quant au Journal inutile du sulfureux Paul Morand, Gérard s’y est attardé sans trop d’hésitation, pas dupe pour un sou concernant le fond du personnage, mais y trouvant largement de quoi butiner : « Léger sentiment de frustration dû à l’envie de lire encore quelques pages… » écrit-il, en date du 10 mai 2001, après avoir terminé la lecture. Signalons encore le non moins problématique Ernst Jünger, et son Soixante-dix s’efface que Delaloye introduit en relevant qu’il n’est « ni banal, ni courant de lire la prose d’un centenaire. » En effet !
Tant d’autres noms, dont celui du bien-aimé Robert Walser, et tant d’autres titres surgissent au gré des semaines et des années, expédiés en quelques lignes ou en quelques pages, et qui contribuent à susciter, chez tout lecteur à l’affût, un appétit du genre féroce.
Les notations personnelles, je veux parler de celles qui concernent la vie de Delaloye en dehors de ses lectures, ne risquent pas d’étouffer le texte. Il y en a malgré tout qui sont plantées comme les petites balises d’une vie privée où la Roumanie n’est jamais très loin. Parfois, le trait devient acide : « Sortie hier du premier numéro de dimanche.ch, avec un édito du propriétaire, Michael Ringier. Nous avons réalisé un bel emballage pour la pub qu’il doit contenir. Cela devrait séduire le consommateur. Pour le reste, rien à dire, car il n’y a rien à lire. ». C’était en date du 29 septembre 1999. Qu’aurait donc dit Gérard, s’il avait été encore parmi nous, en apprenant, le 23 janvier dernier, que la mort par étranglement immédiat venait d’être prononcée contre L’Hebdo, sans autre forme de procès ?
Parfois aussi, et ce sera, je l’espère, une conclusion qui lui aurait plu, le trait sait se faire humble, comme en ce mercredi 22 décembre 2004, où la lecture des Carnets de la drôle de guerre de Sartre le conduit à écrire très lucidement ceci : « De tous les journaux que j’ai lus – et cela commence à compter ! – un seul lui est comparable, le Zibaldone de Leopardi. Là gît la différence entre nous autres, humbles tacherons, petites fourmis, et les génies. Elle est incommensurable. »
(publié sur le blog
http://www.catherine-lovey.com/blog/2017/2/27/pour-saluer-le-voyageur-presque-immobile)